CREIS-TERMINAL a organisé un débat en ligne le mercredi 9 avril 2025
de 18h30-19h45 sur :
Les données de santé, point de vue patient
Intervenante: Sarah Sandré, Membre du CA de CREIS-TERMINAL,de IRIS, de USPN, coordinatrice du GT Santé Numérique du Réseau de Jeunes Chercheur·euses Santé et Société, et juriste au sein de l’équipe « Innovation & Données » en charge de l’entrepôt de données de santé de l’AP-HP.
Débat animé par Christian Papilloud, Professeur des Universités en théorie sociale à l’université de Halle en Allemagne, Directeur du centre de recherche transdisciplinaire « Société et culture en mouvement » et cofondateur du Centre de recherche inter-facultaire santé et société.
L’intervention de Sarah a porté sur :
1/ rappel des droits des patients sur l’accès à leurs données
2/ les données au service des patients ? qui aident le patient à mieux comprendre ou à plus investir dans son parcours de soin / mieux adhérer à sa stratégie de traitement
3/ la valorisation des données avec les patients (donner un statut au patient? Mentionner sa contribution dans les articles ? Etc)
Le diaporama support de son intervention est accessible ici.
VALORISER LES DONNÉES DU POINT DE VUE DU PATIENT – Eléments du débat
1. Les Droits des Patients sur Leurs Données : Focus sur le Portail de Transparence
Le fondement de notre discussion réside dans la reconnaissance des droits inhérents aux patients concernant leurs propres données de santé. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) constitue la pierre angulaire de ces droits. Comme le précise la présentation, le RGPD offre plusieurs possibilités aux individus :
- Le droit d’information, qui stipule que le patient doit être informé de l’usage qui sera fait de ses données. Un exemple concret serait un hôpital expliquant clairement lors de l’admission comment les données seront utilisées, que ce soit pour la recherche, la facturation, etc..
- Le droit d’accès, permettant au patient d’obtenir une copie de son dossier médical électronique, potentiellement via des portails sécurisés comme MesDossiersMédicaux en France.
- Le droit de rectification, qui offre la possibilité de corriger des informations erronées, comme un patient diabétique modifiant son dossier après une erreur de saisie de son taux de glycémie.
- Le droit à l’oubli, qui donne la possibilité de demander la suppression de certaines données, par exemple des données génétiques après un test diagnostique.
Cependant, comme Maurice l’a justement souligné, l’information fournie aux patients est parfois lapidaire. L’exemple de la MGEN signalant la mise en place d’un entrepôt de données sans en préciser les objectifs ni les utilisations illustre ce point. Si l’adhérent dispose d’un droit d’opposition, la concision de l’information peut rendre son exercice difficile. Cette observation rejoint l’idée exprimée dans la présentation selon laquelle l’information doit être aussi individuelle et claire que possible.
Pour concrétiser ce besoin de transparence, la présentation met en avant le portail de transparence. Il s’agit d’une plateforme en ligne rendant publiques les informations relatives aux activités de recherche clinique. Les objectifs d’un tel portail sont multiples :
- Informer le public.
- Permettre aux patients de mieux comprendre la recherche.
- Renforcer la confiance dans la recherche clinique.
- Faciliter l’accès aux résultats.
L’importance de ce portail pour les patients est significative, car il offre un accès centralisé à l’information, favorise une compréhension accrue de la recherche, renforce la confiance et la participation, permet un meilleur suivi et une responsabilisation, et facilite l’exercice des droits.
2. Les Données Comme Moteur de l’Empowerment du Patient : Une Perspective Critique
Nous constatons une sensibilisation croissante des patients au sort de leurs données. L’idée de considérer les patients comme acteurs de la qualité de leurs données est une évolution intéressante, notamment par leur implication dans la collecte via des dispositifs de télésurveillance. Toutefois, il est crucial d’adopter une perspective critique sur cette notion d’empowerment.
Un risque de saturation cognitive, tant pour le patient que pour le praticien, a été soulevé, notamment dans le contexte de la gestion de maladies chroniques comme le diabète.
Quid de l’impact des associations de patient ?
- Les représentants des usagers ou membres d’association de patients sont souvent issus de CSP +. Il est en effet également important de noter que les membres d’associations et les patients-partenaires ont souvent des profils particuliers, avec des niveaux d’études élevés et appartenant à certaines catégories socio-professionnelles, ce qui témoigne d’inégalités sociales dans la représentation.
- L’avancée grâce à l’implication des associations de patients ne risque-t-elle pas de devenir un atout de vente » pour des services numériques dont les intérêts pour les usagers ne sont pas toujours clairs ? L’exemple de plateformes collaboratives comme Carenity, qui utilisent des questionnaires de santé comme monnaie d’échange pour des études dont les résultats restent anonymes, pose une question éthique importante sur la transparence des modèles économiques et la réelle valorisation des données du point de vue du patient.
3. Valoriser les Données AVEC les Patients : Vers un Nouveau Statut dans la Recherche ?
La question du « Quel statut pour le patient ? » est centrale pour une valorisation véritable des données qui tienne compte de leur perspective. La présentation a esquissé plusieurs pistes pour valoriser les données avec l’implication du patient :
- Une mention de leur contribution dans les publications scientifiques et une possibilité d’intervention dans les colloques pourraient reconnaître leur rôle. Cette idée répond à la volonté de ne plus considérer le patient uniquement comme un objet de recherche.
- L’attribution d’un statut de pair-aidant, comme dans certains projets de recherche en oncologie, est une autre voie pour valoriser leur expérience et leur expertise unique.
- Enfin, une valorisation par le biais des représentants des usagers constitue une modalité complémentaire.
Sur l’utilisation de l’engagement des patients comme argument de vente soulève l’importance de clarifier le statut et le rôle des patients impliqués dans la recherche et la valorisation des données. Il est essentiel que leur participation ne soit pas instrumentalisée à des fins qui ne leur bénéficient pas directement ou dont ils n’ont pas conscience.
Nous pourrions faire un parallèle avec la responsabilisation du citoyen dans la gestion des risques, nécessitant une information claire de la part de l’État. Cela fait écho à la nécessité d’une redistribution de l’expertise entre patients et médecins, passant d’une logique de travail « sur » le patient à une logique de travail « avec » le patient, comme le soulignaient les travaux d’Everett Hughes.
En conclusion, la valorisation des données de santé du point de vue du patient est un enjeu complexe et multidimensionnel. Il nécessite non seulement de garantir l’effectivité de leurs droits fondamentaux, notamment par une information claire et accessible, mais aussi de repenser leur rôle dans le processus de recherche et de valorisation. L’idée de passer d’un statut d’objet à celui de sujet actif, dont la contribution est reconnue, est une piste prometteuse pour une approche plus éthique et participative. Les échanges que nous avons eus aujourd’hui enrichissent considérablement cette réflexion et ouvrent la voie à de futures explorations.
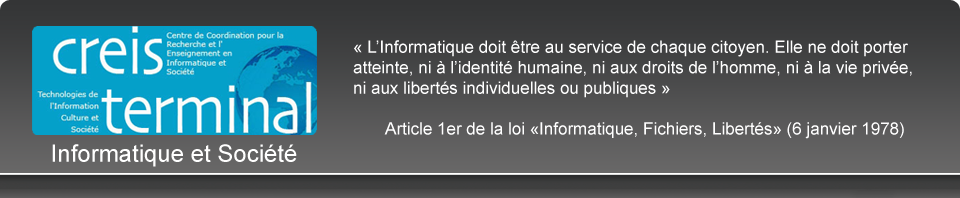
 LDH – Fichage institutionnel
LDH – Fichage institutionnel TERMINAL
TERMINAL Cecil
Cecil David Fayon
David Fayon EPI
EPI IFIP TC9
IFIP TC9 IRIS
IRIS Jeunes Espoir 2000
Jeunes Espoir 2000 LDH Toulon
LDH Toulon SIF
SIF VECAM
VECAM