Débat en ligne organisé par CREIS-TERMINAL
vendredi 28 novembre 17h30-19h
L’année 2025 aura incontestablement été l’année de l’IA juridique : quatre rapports publics ont été publiés depuis la fin d’année 2024, les ouvrages se multiplient sur l’insertion de l’IA dans les pratiques judiciaires, les start ups ne cessent de fleurir (et de faner) et des formations universitaires et professionnelles apparaissent aux quatre coins de l’hexagone pour tenter de se saisir des opportunités, des risques et des questionnements autour de cette transformation accélérée du droit. Il y a pourtant une grande absente des festivités et de l’enthousiasme général : l’open data des décisions de justice, c’est-à-dire la politique publique visant la mise à disposition du public de l’ensemble des décisions de justice rendues par toutes les juridictions françaises. Enclenchée en 2016, reconfigurée en 2019, effectivement lancée en 2021, cette mise en ligne gratuite et en format librement réutilisable des décisions de justice continue presque silencieusement de prendre chaque année quelques années de retard… et pourtant personne, ou presque, ne s’en préoccupe.
La situation tient du parfait paradoxe, pour qui est conscient qu’il n’y a pas d’IA sans données. Pourtant, si l’open data était à l’origine conçue comme l’étape préalable au développement d’une IA juridique performante et opérationnelle, force est de constater que l’IA juridique, elle, n’a pas attendu une open data dès le départ freinée par un mélange d’impréparation technique et théorique. Quasiment dix ans après sa proclamation, l’open data a donc perdu sa seule réelle justification puisque les acteurs du secteur qu’elle était censée soutenir, la Legaltech, ont fait sans elle. Faute d’avoir été conceptualisée autrement que comme une béquille publique à une activité commerciale, l’ambitieuse politique qu’était censée être cet open data des décisions de justice continue aujourd’hui son chemin dans l’indifférence générale.
C’est sur ce paradoxe que nous proposons de nous attarder, en revenant successivement sur les ambitions de l’open data à l’époque de son lancement, puis sur ses défauts et obstacles originels qui expliquent à la fois son retard et son abandon total par le secteur de la Legaltech, et finalement sur la situation actuelle de délaissement de l’open data par l’ensemble des acteurs du droit, qu’ils soient praticiens, universitaires ou acteurs du développement de l’IA juridique.
Intervenante : Camille Bordère, maîtresse de conférences en droit public au sein de l’Université de Caen Normandie (ICREJ, UR 967). Elle est docteure en droit public de l’Université de Bordeaux, où elle a soutenu sa thèse de doctorat (La justice algorithmique. Analyse comparée (France/Québec) d’un phénomène doctrinal) en novembre 2023, et membre de la Chaire Droit public et politique comparés de l’université Jean Monnet Saint-Étienne. Ses recherches s’articulent autour de deux axes principaux : le droit du numérique et de l’intelligence artificielle (avec une particulière attention sur l’utilisation du numérique et de l’intelligence artificielle en droit) et la comparaison des droits. Dans ce dernier axe, elle s’intéresse ainsi plus spécifiquement aux États de la sphère anglo-américaine (Royaume-Uni et Canada) et aux questions de méthodologie de la comparaison.
Débat animé par Kieran Van Den Bergh, doctorant, membre du CA de CREIS-TERMINAL
Inscription obligatoire en envoyant un courriel à contact at lecreis.org précisant prénom, nom, fonction, adresse électronique et téléphone.
Le lien de connexion sera envoyé aux inscrits le 26 ou 27 novembre.
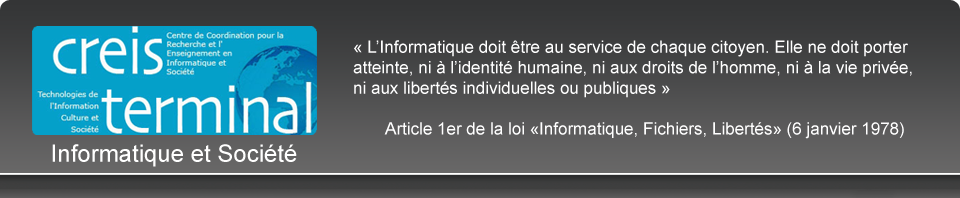
 LDH – Fichage institutionnel
LDH – Fichage institutionnel TERMINAL
TERMINAL Cecil
Cecil David Fayon
David Fayon EPI
EPI IFIP TC9
IFIP TC9 IRIS
IRIS Jeunes Espoir 2000
Jeunes Espoir 2000 LDH Toulon
LDH Toulon SIF
SIF VECAM
VECAM